Barrage de Ligue Conférence : Strasbourg affronte...
Le Racing Club de Strasbourg r...
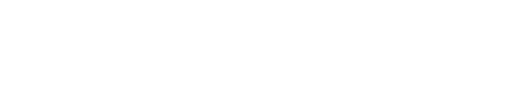
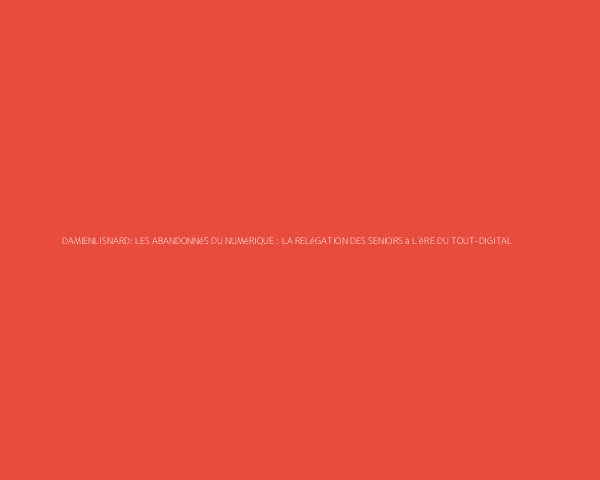
En 2025, la « transformation numérique » de la France est un mantra répété à l’envi. On nous promet une administration plus simple, plus rapide, accessible 24h/24 depuis un smartphone. Mais derrière ce vernis de modernité se cache une réalité brutale et silencieuse : celle de millions de citoyens, majoritairement des seniors, mis au ban de la société. L'« illectronisme », cette nouvelle forme d'analphabétisme, n'est pas un échec individuel ; c'est le résultat d'un choix politique délibéré. Celui d'une dématérialisation à marche forcée qui, sous couvert d'efficacité budgétaire, a engendré une nouvelle forme d'exclusion, abandonnant les plus fragiles sur le bas-côté de l'autoroute de l'information. La dématérialisation, machine à exclure Déclarer ses impôts, prendre un rendez-vous à l'hôpital, actualiser sa situation auprès de France Travail, demander une aide sociale... Des actes essentiels de la vie citoyenne sont devenus un parcours du combattant pour qui ne maîtrise pas l'outil numérique. Le guichet a été remplacé par le portail web, l'agent public par un chatbot, et le contact humain par un labyrinthe de menus déroulants. C'est la grande relégation. Les chiffres, actualisés en 2025 par le dernier baromètre de l'INSEE, sont une véritable bombe sociale. Si 15 % de la population française est touchée par la fracture numérique, ce chiffre explose pour atteindre près de 45 % chez les plus de 75 ans. Cela représente plus de 3 millions de personnes pour qui l'accès aux droits les plus fondamentaux est entravé. Dans ses rapports successifs, la Défenseure des droits, Claire Hédon, ne cesse d'alerter sur ce qu'elle nomme une « déshumanisation » des services publics. On est passé d'un droit à un service à la charge de savoir y accéder. L'État ne garantit plus l'accès à tous ; il exige de tous qu'ils aient les compétences et le matériel pour y parvenir. Quand « l'autonomie » devient une injonction : le mirage des aidants numériques Face à ce désastre social, la réponse des pouvoirs publics est un mélange de déni et de sous-traitance. On a créé le dispositif des « Conseillers Numériques France Services », présentés comme la solution miracle. Mais avec à peine quelques milliers de conseillers sur tout le territoire, souvent en contrats précaires, pour des millions de personnes en difficulté, c'est une rustine sur une fracture béante. Ces conseillers, dévoués mais débordés, ne peuvent pas remplacer la proximité et la pérennité d'un service public physique. Le fardeau de l'accompagnement est en réalité transféré, privatisé. Il repose sur les épaules des familles – les enfants et petits-enfants devenus assistants administratifs par obligation – et sur le tissu associatif. C'est le triomphe du « système D ». Face à des services publics défaillants, le salut passe alors par un voisin patient, un bénévole d'association ou, pour ceux qui en ont les moyens, le recours à des services payants de cours informatique à domicile. L'État se désengage de sa mission fondamentale d'assistance et la transforme en un marché, creusant un peu plus le fossé entre ceux qui peuvent payer pour leur autonomie et les autres. Le coût de la déconnexion : isolement, précarité et non-recours aux droits Cette exclusion numérique n'est pas qu'un simple désagrément technique. Elle a des conséquences humaines et sociales dramatiques. La plus grave est le non-recours aux droits. Combien de personnes âgées renoncent à demander le chèque énergie, l'aide au logement ou le minimum vieillesse parce que la procédure en ligne est un obstacle insurmontable ? Les estimations parlent de plusieurs milliards d'euros d'aides sociales non réclamées chaque année, une économie réalisée sur le dos des plus vulnérables. À la fracture des usages s'ajoute la barrière matérielle. Une panne d'imprimante, un ordinateur bloqué par un virus, et c'est tout l'accès au monde numérique qui s'effondre. Le dépannage informatique La Rochelle et ses équivalents dans d'autres villes deviennent alors des services de première nécessité, un luxe que beaucoup ne peuvent s'offrir pour simplement maintenir un lien avec l'administration. Enfin, la fermeture des guichets physiques (trésoreries, agences postales, caisses de retraite) a détruit des lieux de sociabilité essentiels, aggravant l'isolement de personnes déjà fragilisées. La technologie, qui devait connecter, est devenue un mur. La fracture numérique, un projet politique Ne nous y trompons pas. La situation actuelle n'est pas la conséquence inévitable d'un progrès technologique neutre. Elle est le fruit de décisions politiques et budgétaires visant à réduire la dépense publique en rognant sur la présence humaine. La fracture numérique est un projet qui ne dit pas son nom. L'urgence n'est pas seulement de multiplier les formations au numérique, même si elles sont nécessaires. L'urgence est de réaffirmer un principe fondamental : le numérique doit rester un choix, une option, et non une obligation. Un numéro de téléphone non surtaxé qui répond, un guichet avec un agent formé et à l'écoute, l'envoi de documents papier pour ceux qui le demandent ne sont pas des archaïsmes. Ce sont les conditions d'un service public véritablement universel et humain. Le reste n'est que l'organisation technocratique de l'abandon des plus fragiles.